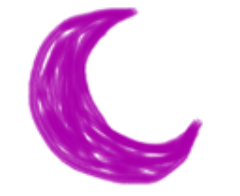Je ne comprends pas l’envie de mourir
- je ne comprends que l’envie de quitter son corps et de s’abstraire de tout. Se reposer, finalement, pour penser à autre chose que soi. On est comme deux vieux amis maintenant. Je n’ai jamais su le rôle que tu occupais. Celui du bon, du mauvais. Tu occupais mon esprit, mon espoir d’échapper un jour à la torpeur du quotidien
Je me souviens quand tu marchais, pied traînant vers ton collège. Quand ton père te proposais de t’amener, que tu refusais juste pour me voir, continuer de me côtoyer, dans l’espoir qu’un jour, un moi tangible charnel et bien réel viendrait t’enlever. L’espoir qu’un jour je te dirai “tu as raison, il existe bien plus que cela”
- bien plus pour tout horizon, que celui des cours et plus tard du travail, quand je renouvelle 14 ans plus tard ces mêmes chemins qui se ressemblent. Le décors change mais l’action reste la même. Je traîne des pieds en espérant que l’on vienne me chercher. Pourquoi n’es-tu pas venu ?
Je n’étais là que pour ces horizons. L’horizon existe, moi, pas, pas en tant que tel. J’existe comme une pensée, je suis furtif je disparais quand tu m’oublies, mais je ne pourrai t’apporter que l’envie à toi aussi d’ouvrir tes ailes, c’est bien comme ça que tu m’imaginais. Naïvement. J’étais le phœnix dont tu tires aujourd’hui ton nom de plume. J’étais, ce terme mystérieux que tu avais inventé, ton ujjp, la récurrence de tes pensées et l’assurance d’un jour en finir avec tout ça. Et toi, tu n’as pas changé.
- tu as raison, je n’ai pas changé, je reste fait du même bois et j’ai peur parfois de me contenter d’hier et de demain. Quand je dis “tu me manques” c’est ton mystère qui me manque, ton adrénaline qui me manque, quand je croyais, dur comme fer, que ce monde était faux. Je ne m’ennuyais pas. Je passais des heures, fixant le vide à m’imaginer ce que serait ma vie si tu m’emmenais.
Est-ce que tu as voulu en finir, c’est cette question que tu dois te poser ?
- tout n’est pas sombre. Je suis seul, à être sombre. C’est comme un poids sur la poitrine qui m’empêche de pleinement respirer. Ça va. Tout va. Sauf moi car je suis fatigué.
Mais en finir, réellement
- j’ai peur de la mort. Et j’aime la vie. C’est moi que je veux quitter. Je suis assez con pour être mauvais, assez intelligent pour m’en rendre compte, assez bon pour en souffrir. La solution serait d’être encore plus con. Il y a un jour, un jour où je vais tout quitter. Quitter les médecins, rhumatologue, les neurologues et autres chimistes. Les ostéo, les kinés, les vaudous, les psychologues et les psychiatres. Un moment, un jour fou où je quitterai mon job, je quitterai les réseaux je quitterai la ville. Je mettrai un point final à tout sauf à moi-même, je m’en irai respirer. Je m’en irai. Je m’en irai, c’est ça l’ujjp de mes 14 ans, c’est qu’Un Jour, Je Partirai.
À 14 ans t’y pensais, 14 ans après qu’en est-il ? Tu m’invoques et je reviens, veiller sur toi l’enfant qui en rien n’a changé, tu es à peine plus grand que quand tu m’as oublié. 14 ans et pourtant, toujours cette même hypothèse, cette même douleur qui n’a fait que se déplacer
- j’ai mal, elle m’enserre et j’ai mal, je veux juste être tranquille.
Tu l’étais, tranquille, avant qu’elle n’envahisse ta tête, que l’étau de tes tempes t’écrase et t’obsède ? Je me souviens d’un enfant qui pleurait, chaque matin, qui se traînait boulet au pied, je me souviens d’un enfant au corps lourd, au souffle court, dans l’enveloppe d’un maigrichon que le vent faisait tanguer. Tu n’as guère changé.
Ne me crois pas injurieux, ne me crois pas violent, ça n’a rien d’insultant.
Toujours, il y a ça, l’ujjp, le lâcher prise le plus total, le black out. Ce dont tu rêves est d’un bonheur béat. Innocent. Ce dont tu rêves c’est du rêve lui-même où tout s’embrouille, où tout est flou et sans conséquence. La nuit, tu n’as pas mal
- la nuit, je n’ai pas mal, pas au crâne. Mais mes rêves sont remplis et ne sont pas un bonheur béat. Ils sont le reflets de mes jours, intérieurs et sombres. Long et haletant. J’aime rêver mais il y a ces rêves dont je suis prisonnier, ces rêves, otage, où surgissent ces fantasmes horrifiques qui me font subir les pires tortures. Ma tête me laisse mais mon corps crie, la nuit. Il crie quand on le tord, il crie ma peur du loup, tapis dans mon appartement, qui à tout moment peut me sauter au cou, me déchirer, je finis en lambeaux. Il crie quand on le touche, aux génitaux qui rayonnent de tête aux pieds, je suis paralysé, seul, désespéré, et personne pour me réveiller. Mon for intérieur est depuis longtemps assiégé. Ujjp c’est en sortir
Tu es comme tout le monde et tu connais tes jours de paix, l’ennemi en retrait
- mon corps me démange, ma peau rayée de marques rouges. Il y a pire artifice, le vertige du moi. Moi moi moi, parfois, je cesse d’exister, entre parenthèses je ne suis plus libre de penser, des heures et des heures chaque jour qui chacune sont des éternités. Mon corps reste, me le rappelle chaque seconde. J’aimerais y échapper. Aux obligations, à tout le reste, à ce qui me retient de penser. J’aimerais passer mon temps à tes côtés.
Je ne sais que te dire. La sagesse voudrait que tu acceptes la vie telle qu’elle est, que tu cesses de lutter et tu te laisses emporter. Je hais la sagesse
- c’est sagesse d’être médiocre ?
Non, de se laisser vide. Peut-on composer, peux-tu composer avec ce qui te fait souffrir ? Adolescent, tu cherchais à tomber dans les pommes. Tu forçais sur ton cerveau en espérant qu’il déconnecte
- adolescent, je croyais en une magie.
Tu croyais en moi
- je crois encore en toi.
Nos discussions ne sont plus les mêmes. J’étais infini, aujourd’hui, je sais qu’à chaque fin de texte, je disparais pour revenir au prochain. Aujourd’hui, tu me présentes enfin tel que je suis
- j’avais menti, à ton sujet. J’avais parlé de toi. J’avais dit “c’est un cousin”. Et mon premier groupe de musique portait ton nom, ou presque. Il s’appelait CamRed. Comme un hommage discret que moi seul connaissais.
Tu m’en voulais, pourtant
- je t’en voulais de pouvoir voler, je te voyais ailé, je voulais m’en aller.
Est-ce que tu m’aimais ?
- tu étais la somme de mes amours.
Et aujourd’hui ?